Reconnecter les datas au monde sensible des humains : un défi de l’industrie 4.0 déjà relevé par les PME
Gérard Dubey, Institut Mines-Télécom Business School et Anne-Cécile Lafeuillade, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
[divider style= »normal » top= »20″ bottom= »20″]
[dropcap]F[/dropcap]ace à l’ampleur des incertitudes et des risques de rupture qui menacent l’ordre économique et social, la numérisation des activités productives est souvent présentée comme une panacée.
Qu’il s’agisse de relocaliser la production industrielle, de créer de nouveaux emplois ou de regagner les gains de productivité perdus, les discours d’accompagnement pour l’industrie 4.0 n’accordent d’intérêt qu’aux potentialités, présentées comme infinies, des solutions numériques.
Les entreprises dites actives dans le domaine du digital sont ainsi présentées comme précurseurs et porteuses de la relance. La crise de la Covid n’a fait qu’accentuer cette tendance qui figurait déjà dans les programmes de l’industrie du futur.
La saisie automatisée des données en aval du processus de production (avec des caméras, des capteurs, une extraction d’information sur chaque poste de travail) et leur traitement algorithmique en amont (big data, data science) est la promesse d’une gestion « agile » (précise, souple, personnalisée) et en temps réel de la production. Ce que recherche tout processus industriel.
Cette transformation numérique semble néanmoins avoir oublié deux faits majeurs : une entreprise est d’abord un collectif d’êtres humains irréductible aux objectifs chiffrés ou aux critères abstraits de productivité. De plus dans l’industrie, le rapport à la matière reste une dimension incontournable, ce qui soude les collectifs de travail et fait aussi sens pour eux.
D’où un certain hiatus, qui ne fait que s’amplifier, entre les ambitions affichées par les grands acteurs institutionnels et la réalité du terrain.
Le rapport des PME industrielles avec la matière
De ce point de vue, les PME industrielles, dont le rôle dans l’innovation (incrémentale) est trop souvent négligé et méconnu, ont beaucoup à nous apprendre. Cela tient notamment au type de rapport spécifique qu’elles continuent d’entretenir avec la matière, si nous entendons par là une réalité aussi bien humaine (les gestes, les savoirs expérientiels, la connaissance sensible) que physique (mesurable). Enracinées sur un territoire et inscrites dans la longue durée, elles sont habituées à nouer, agencer et organiser de manière singulière des savoir-faire et des modes d’intelligence du réel hétérogènes.
Les enquêtes menées dans plusieurs d’entre elles par un groupe de chercheurs pluridisciplinaire témoignent, chez leurs dirigeants, de l’importance de ce rapport. Importance qui se dévoile sous plusieurs aspects et qui affirme l’ancrage de leurs décisions dans le réel de la situation.
Lorsque la PDG de la Maison Caron digitalise son site et déménage à Saclay en 2019, elle ne se sépare pas du « vieux » torréfacteur des années 1950 : certes, la torréfaction du café est ancrée dans le réel et le sensoriel, mais la magie des arômes s’opère parce que le nez, l’œil et même l’oreille savent contrôler ; des savoir-faire traditionnels et familiaux qu’elle partage aujourd’hui avec quelques salariés de l’entreprise.
Chez Guilbert Express, autre entreprise familiale fabricant des appareils de soudure haut de gamme, le dirigeant constate l’effritement progressif des savoir-faire à la française qui a suivi la stratégie de délocalisation de la production vers l’export ces dernières années. Aujourd’hui, il cherche avec la digitalisation de son entreprise, à renouer les collectifs de travail épars autour d’une expérience commune et interculturelle.
À Avignon Céramic, une entreprise du Berry qui fabrique des noyaux céramiques pour l’industrie aéronautique, tout l’enjeu de la qualité réside dans la négociation quotidienne avec la matière. Une matière par nature instable, imprévisible, source de variabilité et d’incertitude, presque « vivante », quasiment douée d’autonomie et qui exige en retour des savoir-faire eux-mêmes vivants, précis, agiles pour faire du produit final une pièce acceptée dans la supply chain des grands donneurs d’ordre.

Dans les industries, les savoir-faire humains permettent de mieux appréhender la matière. Shutterstock
Cela ressort particulièrement bien de l’Opé40, une des étapes clés du processus qualité mis en œuvre pour identifier les défauts des noyaux céramiques. Visuel et tactile, ce contrôle permet d’identifier des détails infinitésimaux et exige une grande expérience. Mais cette étape s’avère aussi décisive dans la construction du savoir collectif et du collectif de travail tout court : si la détection des défauts est l’œuvre de quelques-uns, c’est l’ensemble de la communauté qui s’empare de ces traces pour en restituer le sens à la façon d’une enquête policière.
C’est sous ce rapport à la matière que se noue la communauté de l’entreprise. De ce point de vue les PME apparaissent comme les ultimes détentrices d’un des secrets industriels peut-être le mieux gardé : celui de la façon dont les êtres humains et la matière participent à un processus commun de transformation.
Alors que les dispositifs de traçabilité et d’analyses numériques des données investissent crescendo l’organisation du travail des entreprises en cherchant à capter ces savoir-faire humains parfois ancestraux sur la matière, le défi consiste à intégrer ces transformations sans renoncer à cette culture.
L’humain, clé de l’adaptation
Le dirigeant de AQLE, entreprise du Nord de la France d’assemblages électroniques, quant à lui, soulève la question du risque de la perte de sens pour les salariés si une partie de leur action est prise en charge par le digital. Jusqu’où est-il possible de supprimer des gestes considérés comme pénibles sans altérer à terme l’activité dans son ensemble, c’est-à-dire l’élaboration des savoir-faire, leur maintien et leur acquisition (formation, apprentissage, modalités de transmission) ?
De manière similaire, le décalage observé entre les générations dans l’utilisation des technologies numériques est souvent mis en avant (dans les documents d’incitation) pour faire passer l’idée selon laquelle les plus jeunes pourraient devenir les mentors des plus âgés et servir de relais pour la transformation numérique de l’entreprise. Mais le problème est une fois encore plus intéressant et complexe.

Former les plus âgés n’est pas suffisant pour mener à bien la transformation numérique. Shutterstock
Il s’agit avant tout d’imaginer de nouveaux agencements et équilibres entre le concret (sensible, manuel…) et le digital. L’opposition archaïque/innovant (à laquelle fait souvent écho celle entre cognitif/manuel) apparaît de ce point de vue stérile. C’est le tuilage des pratiques qui compte, non l’approche « disruptive » qui aboutit le plus souvent à des approches hors sol. Tout l’intérêt du numérique est justement de nous inviter à interroger nos modalités d’attachement au travail.
L’un des enjeux d’une « transition numérique » réussie sera sans doute de parvenir à articuler ou à faire coexister dans un rapport de complémentarité plutôt que d’exclusion ces différents modes d’action sur le réel. En acceptant en préambule le constat suivant : l’information obtenue par l’un ou l’autre de ces modes est de nature différente. Le traitement numérique des datas ne peut pas se substituer à une connaissance de la matière qui repose sur la propension des êtres humains à sentir ce qui, comme eux, est vivant, fragile, impermanent.
La familiarité de l’humain avec la matière vivante, loin d’être obsolète, se présente peut-être comme l’une des clés de l’adaptation aux bouleversements présents et à venir. La crise de la Covid est venue fracasser les certitudes, chambouler les stratégies. Le moment est venu de se souvenir que les savoir-faire humains, de même que la mémoire collective sur laquelle ils reposent, ne sont pas que des variables d’ajustement, mais la condition même d’une agilité de plus en plus requise dans une économie globalisée et frappée d’incertitude.![]()
[divider style= »dotted » top= »20″ bottom= »20″]
Gérard Dubey, Sociologue, Institut Mines-Télécom Business School et Anne-Cécile Lafeuillade, Doctorante ergonomie, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

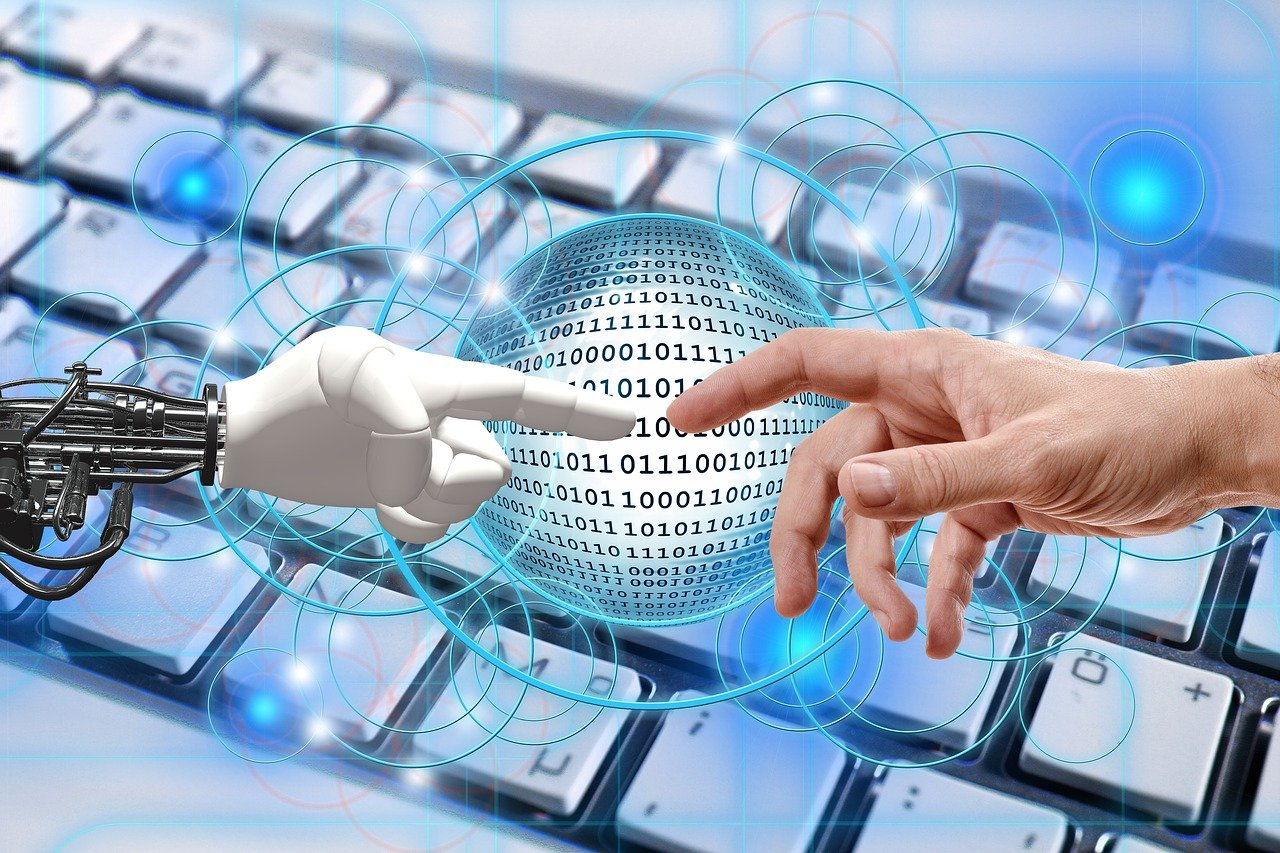



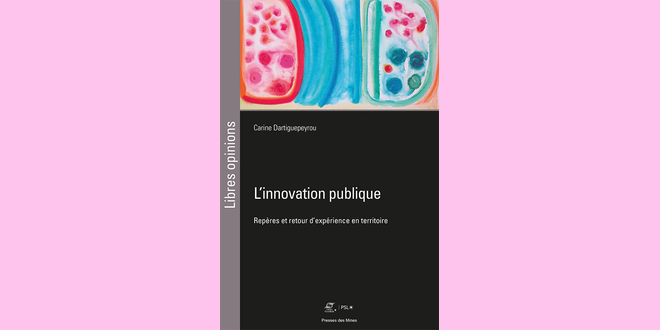

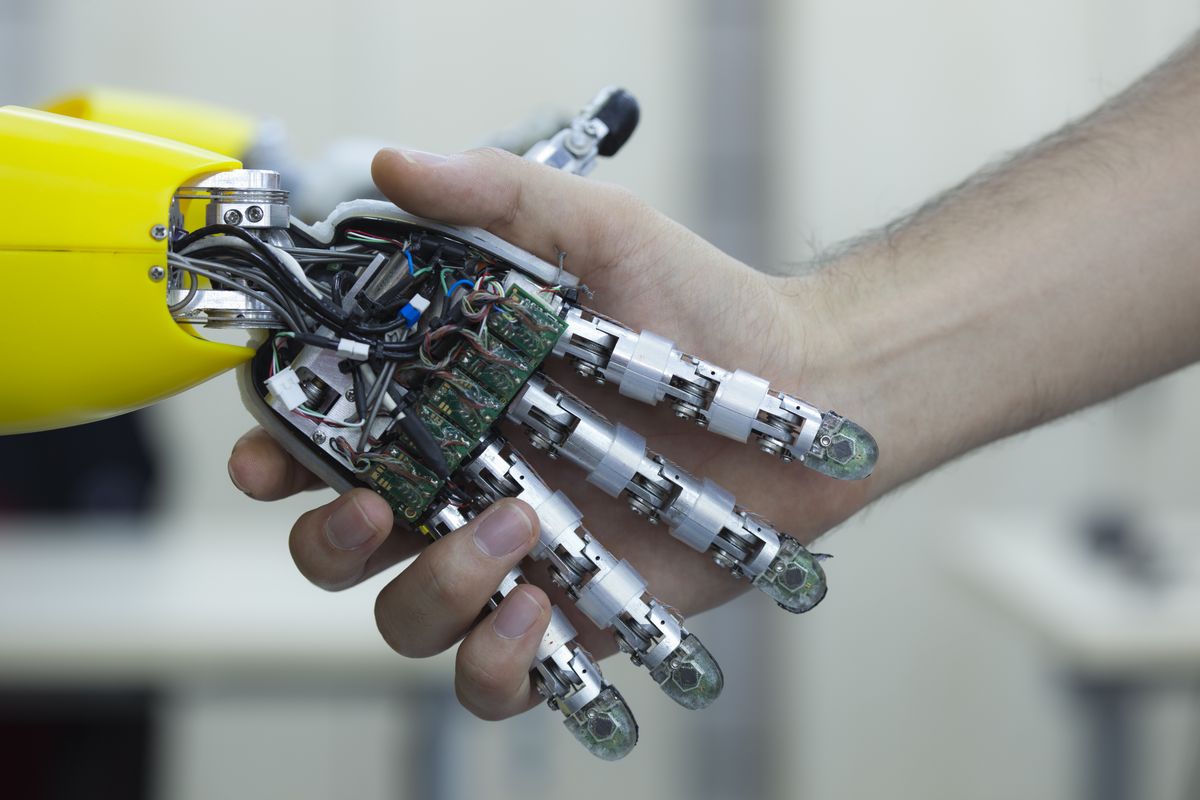

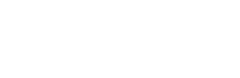


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !